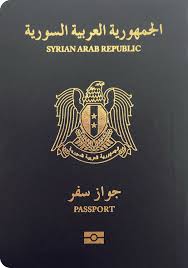
Près d’un an après la chute de Bachar Al-Assad, la Syrie tente de se réinventer, mais l’horizon reste brouillé. La mise en place d’un Parlement provisoire en octobre nourrit autant l’espoir que l’inquiétude. Si cette assemblée transitoire est censée inaugurer une ère nouvelle, elle est déjà critiquée pour son manque de représentativité et l’emprise persistante des islamistes de Hayat Tahrir Al-Cham (HTC), qui contrôlent les principaux rouages du pouvoir. Le risque est réel de voir se reconstituer une architecture autoritaire sous des habits neufs, où l’exécutif conserve la haute main sur la vie politique.
Cette difficile normalisation se joue aussi sur le terrain diplomatique, dans un environnement régional empoisonné. Le président de transition, Ahmed Al-Charaa, a multiplié les gestes symboliques — de son discours à l’ONU à ses rencontres avec les dirigeants occidentaux — pour rompre l’isolement dans lequel le régime Assad avait enfermé la Syrie. Ces efforts redonnent à Damas une certaine visibilité internationale, mais ils se heurtent à des obstacles considérables.
Israël multiplie ses frappes sur le territoire syrien, ciblant tour à tour des dépôts d’armes, des positions militaires et des responsables soupçonnés de liens avec l’Iran. Ces actions fragilisent davantage le processus de reconstruction étatique en rappelant que le pays reste un champ de confrontation par procuration. Washington, de son côté, conditionne son soutien à des avancées concrètes en matière de lutte contre le terrorisme et de respect des minorités, tout en maintenant des sanctions économiques qui étranglent une économie déjà exsangue.
Le contexte plus large du Moyen-Orient complique encore la tâche. La guerre à Gaza, les tensions permanentes au Liban, l’affaiblissement de l’Iran sous le coup des sanctions et des bombardements israéliens, ainsi que la montée en puissance d’une Turquie de plus en plus autoritaire, créent un climat de recomposition régionale. Dans ce tumulte, la Syrie peine à trouver sa place, oscillant entre les attentes pressantes des grandes puissances, les calculs de ses voisins et les aspirations contradictoires de sa propre population.
Au cœur des doutes, une question centrale demeure : la Syrie est-elle capable de bâtir un État impartial, garant de l’égalité entre ses citoyens ? Les massacres récents contre les minorités alaouite et druze rappellent la profondeur des fractures confessionnelles, tandis que les promesses de justice transitionnelle peinent à se traduire en actes. La méfiance des minorités reste forte, nourrie par le passé récent et les comportements ambigus des nouvelles forces de sécurité.
L’élection du Parlement transitoire le 5 octobre sera un test décisif. Plus qu’un scrutin, il s’agira de mesurer la capacité des nouvelles autorités à s’extraire d’une logique de domination islamiste et à donner un espace aux technocrates, aux femmes et aux minorités. Ce processus fragile pourrait ouvrir la voie à une reconstruction politique et institutionnelle, mais il pourrait aussi renforcer les logiques d’exclusion si l’Assemblée devient une simple chambre d’enregistrement.
La Syrie se trouve ainsi au carrefour de son histoire : entre le risque de replonger dans l’autoritarisme sous d’autres formes et la possibilité d’engager un véritable processus d’inclusion nationale. L’avenir dépendra autant de la volonté des nouvelles élites que du soutien de la communauté internationale, appelée à accompagner sans dicter, encourager sans enfermer.
Poster un Commentaire