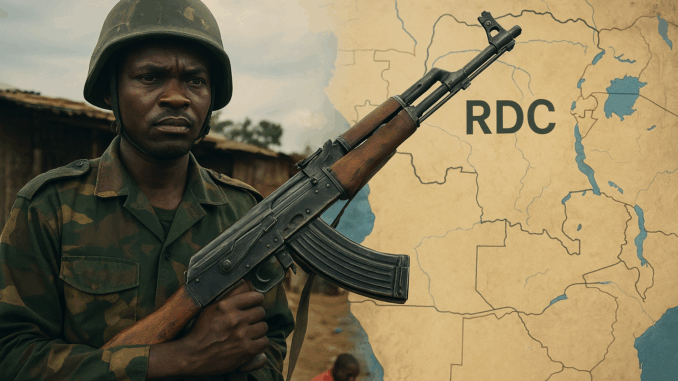
Alors que le processus de paix en République démocratique du Congo peine à s’imposer, les tensions politiques internes et les rivalités régionales menacent de faire dérailler les efforts de stabilisation.
Malgré la signature d’un cessez-le-feu permanent entre Kinshasa et les rebelles du M23 sous médiation américaine et qatarie, les combats se poursuivent dans l’Est du pays. L’armée congolaise accuse le mouvement armé d’avoir reçu des renforts venus du Rwanda, tandis que le M23 reproche au gouvernement de violer les engagements pris. Cette guerre de mots masque une réalité plus brutale : celle d’un front mouvant où les civils continuent de payer le prix fort.
Le cessez-le-feu, présenté comme une avancée diplomatique majeure, reste en réalité une construction fragile. Chaque attaque, chaque déclaration enflamme à nouveau la défiance. L’absence d’un mécanisme de suivi efficace et la faiblesse des moyens déployés sur le terrain rendent la paix aussi fragile qu’un incendie éteint dont les braises rougeoient encore. Les médiations de Doha et de Washington ont certes ramené les protagonistes autour d’une table, mais aucune ne parvient encore à transformer la parole en acte.
À cette fragilité militaire s’ajoute une tension politique interne grandissante. Le bras de fer entre le pouvoir et le camp de l’ancien président Joseph Kabila, dont le parti PPRD vient d’être suspendu, accentue la polarisation à Kinshasa. La dissolution de plusieurs partis d’opposition et la concentration du pouvoir entre les mains du président Félix Tshisekedi alimentent un climat de méfiance. Dans un tel contexte, le risque est grand de voir les fractures politiques internes affaiblir la position du gouvernement sur la scène diplomatique.
Pendant ce temps, l’Est du pays s’enfonce dans une crise humanitaire sans précédent. Plus de 28 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire, des millions d’autres sont déplacées, et les violences sexuelles atteignent des niveaux insoutenables. La conférence internationale de Paris, organisée par Emmanuel Macron et Faure Gnassingbé, a permis de mobiliser plus d’un milliard et demi d’euros d’aide pour la région des Grands Lacs. Mais les promesses financières ne suffisent pas : sans coordination régionale et sans transparence, l’aide risque de nourrir la dépendance plutôt que la reconstruction.
La stabilité de la RDC ne peut pas reposer uniquement sur les efforts extérieurs. Les pays africains doivent jouer un rôle central dans la résolution du conflit. Comme l’a rappelé le président togolais Faure Gnassingbé, « on ne peut pas répondre indéfiniment au long terme avec des outils de court terme ». L’Union africaine, la Communauté d’Afrique de l’Est et la SADC doivent s’impliquer davantage, non seulement comme médiateurs, mais comme garants de la mise en œuvre des accords.
L’avenir du pays dépendra de la capacité des dirigeants congolais et africains à rompre avec les cycles d’accords non tenus et de promesses non appliquées. Sans une appropriation continentale du processus de paix, la RDC restera le théâtre d’une instabilité chronique où les cessez-le-feu servent plus à gagner du temps qu’à bâtir l’avenir. La paix, ici comme ailleurs, ne tiendra que si elle s’ancre dans la volonté politique des Africains à construire leur propre sécurité.
Poster un Commentaire